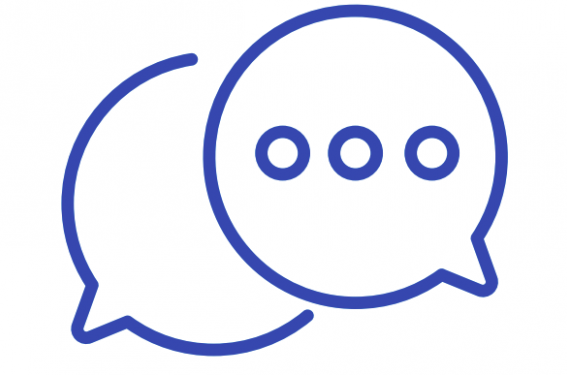Editorial
Publié le 24 mar 2025Lecture 3 min
Vous reprendrez bien une petite polémique ?
Benjamin AZÉMAR, Rédacteur en chef
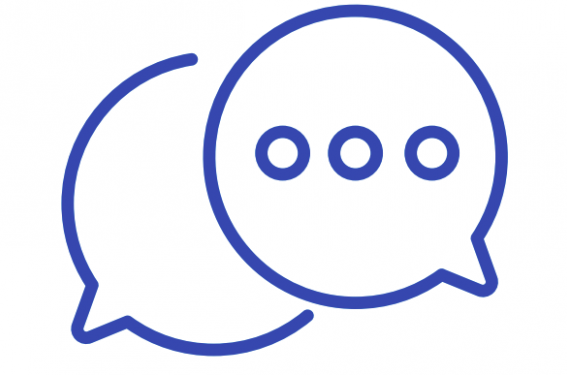
On pourrait croire que certains progrès sanitaires sont suffisamment ancrés dans notre mémoire collective pour ne plus être remis en cause… On aimerait bien en tout cas, même si les vagues successives de vaccino-scepticisme ces dernières années auront probablement douché les plus optimistes. Las, c’est désormais la vitamine D qui a droit aux honneurs de la complosphère. La nouvelle mode : l’accuser, entre autres, d’être à l’origine des « coliques du nourrisson », par un mécanisme au fondement scientifique douteux (ce sont les traces d’orange qui seraient la cause de ces pleurs qu’on qualifie d’inexpliqués, pleurs inhérents aux premiers mois de vie et demeurés jusqu’ici aussi anciens que mystérieux). Ou encore, d’être un perturbateur endocrinien – la locution étant en ellemême suffisante pour déclencher une polémique.
D’ailleurs, si on lance une recherche internet avec les mots : « vitamine D polémique » (méthodologie douteuse mais malheureusement assez répandue), les recherches associées qui apparaissent sont : « pourquoi la vitamine D est un perturbateur endocrinien ? », « pourquoi arrêter la vitamine D ? », ou encore « la vitamine D est-elle nocive pour les reins ? ». Sans pour autant faire apparaître de résultat probant pour soutenir ces différentes questions, elles-mêmes pour le moins orientées.
C’est bien notre mémoire collective qui est défaillante, ici, sur les bienfaits de la vitamine D. Un sondage grand public sur la définition du mot rachitisme aboutirait sûrement à une majorité de « maigreur » ; la croissance staturale serait probablement évoquée par certains ; mais il est peu probable que le métabolisme phosphocalcique ou même l’huile de foie de morue y soient significativement cités. C’est que, d’observations en découvertes, au fil des siècles (et notamment au XXe), le rachitisme carentiel a été réduit au statut de maladie oubliée. Ou presque.
La supplémentation médicamenteuse des enfants en vitamine D, fer de lance de cette bataille contre le rachitisme, est désormais suffisamment ancienne pour avoir porté ses fruits. Les données d’efficacité et de tolérance ont permis plusieurs ajustements ; le dernier remonte d’ailleurs à 2022, le consensus français rejoignant à cette occasion les recommandations européennes de 2013.
Le modèle épidémiologique soulevé par cette polémique est intéressant à manipuler : en caricaturant un peu, il faudrait aujourd’hui (re)démontrer, au moyen d’essais contrôlés randomisés, que la supplémentation en vitamine D empêche la survenue d’une maladie quasi disparue (le rachitisme) sans favoriser la survenue d’effets indésirables eux-mêmes fréquents et aspécifiques (les coliques). Une belle usine à gaz.
D’ailleurs, le grand public et certains soignants ont décidé de ne pas attendre qu’une telle étude voie le jour : au nom sans doute du principe de précaution (?), on observe de plus en plus de supplémentations non médicamenteuses, via des compléments alimentaires au contenu imprécis et/ou hors de tout contrôle sanitaire, avec des risques de sous- ou surdosage ou encore d’association malheureuse.
Pour tenter d’enrayer ce phénomène, la SFP et d’autres sociétés savantes pédiatriques ont publié le 29 janvier dernier un communiqué de presse(1) destiné à rappeler les bonnes pratiques : une supplémentation de 0 à 18 ans avec des doses contrôlées de vitamine D2 ou D3, via des produits bénéficiant des contrôles propres au circuit du médicament. Souhaitons que ce nouveau rappel (puisqu’il s’agit du deuxième communiqué de presse en 6 mois(2)) permette d’éviter des conséquences qui, même si elles auraient toutes les chances d’échapper aux radars de la santé publique, n’en seraient pas moins regrettables.
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :